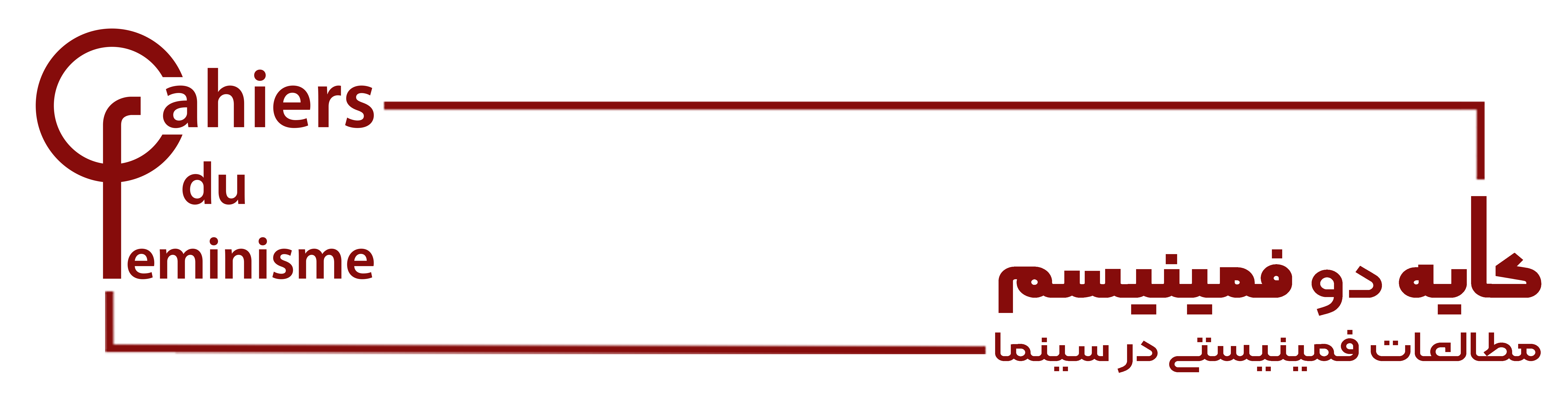Le vendredi soir semble être l’histoire de deux sœurs qui se retrouvent après des années de séparation. Banafché, maintenant que son père est malade, a décidé de réunir à nouveau les membres de la famille, cherchant à alléger le remords de son père pour avoir chassé Shaghayegh, afin que le vieil homme puisse peut-être mourir en paix. De l’extérieur, la recherche de Shaghayegh par Banafché paraît peu probable.Elle est à la recherche de quelqu’un, dans les souvenirs éffacés des gens, qui n’est pas très différent des autres, une personne dont le nom véritable est caché aux yeux de tous. Banafché rend visite à des gens et des lieux qui, en toute logique et en connaissant cette ville chaotique, ne devraient pas lui apporter de réponse. Téhéran n’est pas une ville où l’on peut trouver des informations sur un ouvrier, un prisonnier, un aide-soignant ou un employé d’il y a dix ans ou bien essentiellement s’en souvenir.Téhéran, du moins dans son apparence et plus encore dans la manière dont il est dépeint dans ce film, est une ville de personnes et de relations insignifiantes.Le réalisateur choisit deux personnages parmi des milliers de femmes.
À la place de Shaghayegh, il pourrait y avoir d’innombrables femmes appartenant à la même classe, avec une vie plus ou moins similaire. Elles pourraient être abandonnées par leur mari ou forcées au divorce, errant dans la ville avec un enfant aux prises avec les défis de l’adolescence, rejetées par leur famille, cherchant refuge et de quoi manger. La plupart d’entre elles travaillent dans des ateliers de couture, des salons de beauté, ou font des ménages. Un emploi précaire qui ne leur permet jamais d’avancer significativement, leur situation ne changera jamais, et en même temps beaucoup d’entre elles sont attachées à un homme qui, si ce n’est pas aujourd’hui les dévera certainement demain.
C’est pourquoi Shaghayegh est aussi Serment et si l’agresseur d’hier n’est plus vivant, un autre traître a pris sa place, prêt à fuir avec le peu d’argent de Shaghayegh. C’est pourquoi Shaghayegh, en travaillant avec une cliente, parle d’une femme qui, comme elle il y a des années, est enceinte et ne sait pas quoi faire de son enfant. Shaghayegh et Banafshé, comme l’enfant de Shaghayegh, comme son agresseur, son amant infidèle et son père, ne sont pas destinés à se démarquer par des caractéristiques uniques. Même la recherche de Shaghayegh, qui semble difficile au départ, se révèle être un chemin si facile au point que même l’esprit du spectateur ne s’en préoccupe pas vraiment. Ce n’est pas la traversée de cette route difficile qui importe, mais la vision d’un réseau de chemins enchevêtrés, tous menant finalement à la gueule de l’araignée. Ce réseau tissé comporte de nombreux nœuds, mais chacun d’eux fait partie d’une structure uniforme et similaire. En fait, toutes ces routes et destinations, vues sous un certain angle, se ressemblent : ce sont les chemins des “victimes”.

D’innombrables femmes comme Shaghayegh se débattent, font des efforts et pensent qu’elles avancent et s’éloignent de cette misère écrasante que leur genre leur impose dans la société, mais en réalité, leurs déplacements ne sont que des passages d’un point de la toile à un autre. Ce qu’elles voient et qui leur semble porteur d’espoir n’est qu’une autre place de victime qui scintille de loin et les attire. La distance que le réalisateur maintient dans son récit vis-à-vis de cet événement particulier met avant tout en évidence cette vaste toile. L’un des effets de cette perspective lointaine et de cette distance est de réduire l’empathie du spectateur. Pour le spectateur, il importe probablement peu que le père meure avant de revoir Shaghayegh, ou que l’enfant de Shaghayegh se jette du haut du pont ; l’atteinte de Banafché à son objectif de réunir la famille n’est pas si importante. Le spectateur, à cette distance, comprend bien l’insignifiance de chacun de ces événements dans le changement de la structure globale.
Problème est omniprésent, dans les heures et la manière d’entrer et de sortir du foyer, dans les relations dans les ateliers, dans le comportement des employeurs et des dentistes, dans le regard des voisins et une culture qui leur donne le droit d’enquêter et de poser des questions, une culture qui rejette les enfants sans père, une famille qui ne connaît pas l’amour inconditionnel pour ses enfants, etc. Dans ces conditions, le seul mouvement possible est sur cette toile, et la seule échappatoire, celle à laquelle pense le garçon en haut du pont : la chute. Même si le déplacement sur cette toile peut parfois être le résultat de choix personnels, il est inextricablement lié à la faiblesse et à l’apitoiement des autres. Il n’y a pas de “droit” défini que l’on peut réclamer en tant qu’être humain, un droit qui leur appartiendrait automatiquement. Il faut supplier, demander, pleurer, ou attendre que quelqu’un comme Madame Bolour croise leur chemin pour les aider par humanité, sinon, comme dit Shaghayegh, on ne sait pas où ils finiront.
En vérité, même si le père tyrannique d’hier cherche aujourd’hui sa fille, il est désormais entré dans cette toile en tant que victime et cherche sa fille en position de faiblesse. Le fils de Shaghayegh n’accepte sa mère à nouveau qu’après avoir appris les circonstances de sa naissance, ce qui le rend encore plus méfiant envers son existence. Probablement, à partir de maintenant, avec l’arrivée du père et de la sœur dans la vie de Shaghayegh, vivre dans des appartements avec des voisins gênants
sera plus facile pour elle, mais cela ne signifie pas qu’elle quitte cette toile. Cela signifie simplement la stabilisation de sa position fragile et précaire sur cette toile, les autres remplissant les nœuds autour d’elle, alourdissant la toile, la stabilisant et la faisant moins bouger. Lorsque plus de choses se trouvent à cet endroit prédéterminé, où la coutume et l’habitude l’ont fixé, une sécurité apparente est établie, mais pour celui qui est assis loin et a une vue d’ensemble de la toile, pour le spectateur, il n’y a aucune échappatoire à la gueule toujours affamée de l’araignée.